Épisode 52 : Elias – « Guerre(s) du Futur ».
Je suis très heureuse d’accueillir Elias Brugidou pour discuter de son mémoire de M2 en science politique – relations internationales, « Les Voyants et les Gardes. Pratiquer et légitimer la narration visuelle d’anticipation comme expertise sécuritaire aux États-Unis et en Europe ». Elias a réalisé son mémoire sous la direction du professeur Thierry Balzacq à Sciences Po Paris.
Dans cet épisode du Dazibao, je reçois Elias, pour parler de son mémoire consacré à la narration visuelle d’anticipation comme expertise sécuritaire. Son travail explore une question fascinante : comment les armées, aux États-Unis et en France, utilisent la narration visuelle et les imaginaires de science-fiction pour construire et présenter les menaces « émergentes » et le futur de la guerre.
Intitulé « Les Voyants et les Gardes. Pratiquer et légitimer la narration visuelle d’anticipation comme expertise sécuritaire aux États-Unis et en Europe », le mémoire d’Elias s’intéresse particulièrement à deux programmes emblématiques :
– le projet Future Conflict Graphic Novels, produit entre 2018 et 2023 par l’Army Cyber Institute américain,
– la Red Team Défense, initiative française lancée en 2019 par l’Agence de l’innovation de Défense.
Ces programmes font appel à des auteurs et illustrateurs de science-fiction pour imaginer les guerres de demain. À travers la bande dessinée, le roman graphique ou des récits transmédias, ils proposent des scénarios d’anticipation qui nourrissent la réflexion militaire.
Elias interroge ici la légitimité de ces productions : comment la fiction devient-elle une forme d’expertise ? Et que nous disent ces récits sur les représentations contemporaines de la guerre, des menaces et des ennemis ?
Son enquête revient d’abord sur la longue histoire de la science-fiction comme outil d’anticipation : de Hulk et X-Men pendant la guerre froide, métaphores des tensions nucléaires et des discriminations, jusqu’au tournant cyberpunk des années 1980, où la critique sociale se teinte d’une fascination pour le capitalisme et la technologie.
Cette évolution se prolonge par la naissance du design fiction, lorsque des entreprises ou des institutions font appel à des auteurs pour produire des récits prospectifs, désormais au service de la stratégie, de la sécurité ou du marketing.
Dans la sphère militaire, ces pratiques s’inscrivent dans une transformation plus large des pratiques d’anticipation : la guerre du Golfe a nourri l’illusion d’une prévisibilité totale grâce à la technologie, jusqu’au choc du 11 septembre 2001 qui a révélé les limites de cette certitude. Dès lors, les armées cherchent à réintroduire l’imagination dans leur réflexion : simulations, fictions, scénarios deviennent autant de moyens de penser l’imprévisible.
Elias analyse ces récits comme des dispositifs de sécuritisation : des outils narratifs et visuels qui contribuent à définir ce qui constitue une menace. Ses analyses montrent comment ces fictions mettent en scène une typologie d’ennemis régulièrement traversée par des représentations racialisées et des imaginaires orientalistes.
Les villes sanctuaires, les mégalopoles sauvages ou les États voyous y dessinent un paysage visuel de la peur et de la vigilance.
Le contexte politique et culturel pèse lourdement sur ces productions : guerre en Ukraine, pandémie de COVID-19, crise écologique, débats français autour du wokisme, du communautarisme ou de l’écoterrorisme. Certains scénarios de la Red Team présentent ainsi des activistes écologistes ou des militants altermondialistes comme des figures de menace, au risque de brouiller la frontière entre contestation sociale et danger intérieur.
Enfin, Elias explore les publics et les usages de ces récits : militaires, élus, partenaires internationaux, jeunesse. Les uns y voient un outil de sensibilisation ou de cohésion, les autres un moyen de légitimer certaines orientations budgétaires. Dans tous les cas, ces récits participent à une « visualité vigilante » : une culture de l’attention aux menaces, où la fiction devient un instrument politique et sécuritaire.
Un épisode qui interroge avec finesse la fabrique visuelle de la sécurité et la manière dont nos imaginaires collectifs, entre Hollywood, bande dessinée et stratégie militaire, façonnent les guerres à venir.
Newsletter
Chapitrage
0:00 – Introduction
Elias Brugidou revient sur son parcours : son intérêt pour les relations internationales à travers la littérature universitaire de gauche, et son attrait pour les questions de défense et de sécurité.
Issu d’une famille de chercheurs, il découvre la science-fiction et les imaginaires militaires grâce à un proche, chercheur en esthétique.
Évocation d’Alain Damasio et de la polémique autour de la participation d’auteurs de SF à la réflexion militaire.
10:31 – Questions de recherche
Constat : les armées financent et diffusent depuis longtemps des œuvres culturelles, sans les considérer comme de véritables outils d’expertise.
Le mémoire étudie comment des récits visuels (BD, fictions transmédiatiques) peuvent servir à penser et anticiper la guerre du futur, en transformant l’imagination en forme d’expertise.
16:31 – L’art comme outil d’anticipation
Retour sur l’histoire de la SF politique : Hulk et X-Men pendant la guerre froide, BD européennes libertaires (Bilal), SF contestataire des années 1960-70.
Évolution vers le cyberpunk (Gibson, Sterling) et l’essor du design fiction, d’abord critique, puis récupéré par les grandes entreprises et institutions.
25:08 – Le raisonnement conjectural dans les armées
Genèse des programmes Red Team Défense (France) et Future Conflict Graphic Novels (États-Unis).
Naissance dans les années 1990, après la guerre du Golfe et la croyance en la toute-puissance technologique.
Le 11 septembre marque un tournant : retour à des formes d’anticipation fondées sur la fiction, la simulation et l’imagination.
33:52 – La réception de la Red Team en France
D’abord perçue comme un outil de communication, puis prise au sérieux.
Aux États-Unis, tradition plus ancienne de collaboration entre armée et culture populaire (Hollywood, comics).
En France, débats vifs : participation d’auteurs sous pseudonyme, SF française historiquement marquée à gauche.
39:35 – Présentation des deux projets étudiés
– Future Conflict Graphic Novels (2018–2023) : projet américain de l’Army Cyber Institute. Scénarios écrits par le futuriste Bryan David Johnson, illustrés par des artistes issus du monde des comics.
– Red Team Défense (2019–2023) : projet français porté par l’AID, impliquant auteurs, illustrateurs et militaires dans une création transmédiatique.
Collaboration entre Red Team (créatifs), Blue Team (militaires) et Purple Team (universitaires, civils).
47:11 – Analyse sociologique des récits
Approche par la sécuritisation : comment un enjeu devient un enjeu de sécurité.
Étude des représentations des menaces : ennemis anonymes, terroristes, traîtres, foules irrationnelles ou États voyous.
Lecture critique des imaginaires : dimension orientaliste, stéréotypes raciaux et genrés.
58:31 – Contexte politique et culturel
Les récits s’ancrent dans les grandes crises contemporaines : guerre en Ukraine, pandémie de Covid, urgence environnementale.
Aux États-Unis, empreinte du 11 septembre ; en France, débats autour du « wokisme », du communautarisme et de l’écoterrorisme.
Certaines BD reprennent de manière caricaturale les codes militants ou écologistes, suscitant la controverse.
1:09:50 – La grammaire visuelle
Étude du dessin et des codes visuels partagés : interfaces technologiques, pictogrammes, filtres bleutés, effets de futur.
Usage d’images opératoires (Harun Farocki) et d’éléments issus de la culture numérique (influenceurs, réseaux sociaux).
1:16:05 – Réception et impact
Publics visés :
– Militaires et partenaires de l’OTAN (harmonisation des menaces, alliances occidentales)
– Élites politiques (justification budgétaire et stratégique)
– Grand public et jeunesse (sensibilisation, « visualité vigilante »).
Référence au projet Myriade sur la guerre cognitive, issu de la Red Team Défense.
1:27:34 – La guerre cognitive
Le cerveau devient un champ de bataille : réflexion sur la manipulation des opinions et la frontière entre contestation et influence étrangère.
1:30:27 – Suites et prolongements
En France, le programme RADAR succède à la Red Team, porté par la DGA.
Immersion conjointe de civils et militaires dans des scénarios prospectifs, parfois diffusés sur Twitch.
Logique de sécuritisation par le sensible.
1:36:46 – Accès aux sources
Difficultés d’accès : réserves des civils impliqués, embargo aux États-Unis.
Recours à des acteurs périphériques (design fiction) pour contourner ces obstacles.
1:39:37 – Ouverture du sujet
Perspectives de recherche : réception des récits par les audiences, guerre informationnelle et cognitive.
1:43:25 – Vers le doctorat
Année de césure pour tester d’autres milieux (douanes, Assemblée nationale, IHEDN).
Constat : retour nécessaire à la recherche pour retrouver liberté et rigueur intellectuelle.
1:47:01 – Conseils pour un futur doctorant
Garder la flamme, être lucide sans cynisme.
Ne pas choisir un sujet pour sa mode, mais pour son intérêt durable.
Les enjeux de sécurité offrent des opportunités de financement (IRSEM), malgré la précarité académique.
Extraits
Ressources complémentaires
- Amoore, Louise. 2007. « Vigilant Visualities: The Watchful Politics of the War on Terror ». Security Dialogue 38(2): 215‑32.
- Andersson, Jenny. 2018. The Future of the World: Futurology, Futurists, and the Struggle for the Post-Cold War Imagination. Oxford: Oxford University Press.
- Aradau, Claudia, et Rens Van Munster. 2011. Politics of Catastrophe: Genealogies of the Unknown. London: Routledge.
- Balzacq, Thierry. 2005. « The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context ». European Journal of International Relations 11(2): 171‑201.
- Balzacq, Thierry. 2011. « Enquiries into methods: A new framework for securitization analysis ». In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, éd. Thierry Balzacq. Londres: Routledge, 31‑53.
- Berling, Trine Villumsen, et Christian Bueger. 2015. « Security expertise: An introduction ». In Security Expertise: Practice, Power, Responsibility, éd. Trine Villumsen Berling et Christian Bueger. Londres: Routledge, 1‑18.
- Bigo, Didier. 2006. « Internal and External Aspects of Security ».
- Bleiker, Roland. 2001. « The Aesthetic Turn in International Political Theory ».
- Bleiker, Roland. 2015. « Pluralist Methods for Visual Global Politics ».
- Bleiker, Roland. 2017. « In Search of Thinking Space: Reflections on the Aesthetic Turn in International Political Theory ».
- Boltanski, Luc, et Ève Chiapello. 2011.
- Carr, Matt. 2010. « Slouching towards Dystopia: The New Military Futurism ».
- Dunn Cavelty, Myriam. 2019. « The materiality of cyberthreats: securitization logics in popular visual culture ». Critical Studies on Security 7(2): 138‑51.
- Eyal, Gil. 2002. « Dangerous Liaisons between Military Intelligence and Middle Eastern Studies in Israel ».
- Faux, Emily, et Rebekah K. Pullen. 2025. « A cinematic catalyst for (Re)thinking nuclear narratives ».
- Gomes, Mariana Selister, et Renata Rodrigues Marques. 2021. « Can Securitization Theory Be Saved from Itself? A Decolonial and Feminist Intervention ».
- Guittet, Emmanuel-Pierre, et Julien Pomarède. 2019. « Arpenter les territoires du secret. Pistes de recherches ».
- Hansen, Lene. 2011. « Theorizing the Image for Security Studies: Visual Securitization and the Muhammad Cartoon Crisis ».
- Nixon, Nicola. 1992. « Cyberpunk: Preparing the Ground for Revolution or Keeping the Boys Satisfied? »
- O’Hagan, Jacinta. 2023. « The ‘West’ in International Relations ». In
- Pantenburg, Volker. 2016. « Working Images: Harun Farocki and the Operational Image ». In
- Pelopidas, Benoît, Hebatalla Taha, et Tom Vaughan. « How dawn turned into dusk: Scoping and closing possible nuclear futures after the Cold War ».
- Policar, Alain. 2022. « De woke au wokisme : anatomie d’un anathème ».
- Pomarède, Julien. 2021. « Imagining (in)Security: NATO’s Collective Self-Defence and Post-9/11 Military Policing in the Mediterranean Sea ».
- Robinson, Nick, et Marcus Schulzke. 2016. « Visualizing War? Towards a Visual Analysis of Videogames and Social Media ».Rose, Gillian. 2016.
- Sangar, Éric. 2024. « Sécuriser l’avenir pour mieux militariser le présent ? Le projet de la Red Team du ministère des Armées français ».
- Stampnitzky, Lisa. 2013. « Experts, États et théorie des champs. Sociologie de l’expertise en matière de terrorisme ».Taylor, Philip M. 2003.
- Truc, Alexandre. 2023. « « Écoterroristes » et « terroristes intellectuels » : Retour sur de (pas si) nouvelles pratiques de gouvernement ».
- Vauchez, Antoine. 2008. « The Force of a Weak Field: Law and Lawyers in the Government of the European Union (For a Renewed Research Agenda) ».
- Vauchez, Antoine. 2011. « Interstitial Power in Fields of Limited Statehood: Introducing a “Weak Field” Approach to the Study of Transnational Settings ».
Recommandations culturelles :
Jeux vidéos
- Disco Elysium
- Cyberpunk 2077
- Citizen Sleeper
- Fallout New Vegas
Mangas
- Devilman
- Le Pacte de la mer
- Chainsaw man
- Choujin X
Bande-Dessinées
- Bolchoi Arena
- Shangri-La
- Frontier
Romans
- The City and the City
- Ubik
- Le Neuromancien
- Dune
- La Taupe
Film, films et séries d’animation
- Stalker
- Akira
- Ghost in the Shell )
- Utopia
- Neon Genesis Evangelion
- Serial Experiments Lain
Podcast
- Blowback
Youtube
- Bolchegeek
- C’est pas sourcé
- Grégoire Simpson
- Politikon
- Folding Ideas
Musique
- He Has Left Us Alone but Shafts of Light Sometimes Grace the Corner of Our Rooms…
- F♯ A♯ ∞
Pour ne rien rater et en apprendre plus sur les coulisses du podcast 🎭 :
Merci pour votre soutien 🔥 !
Marjolaine



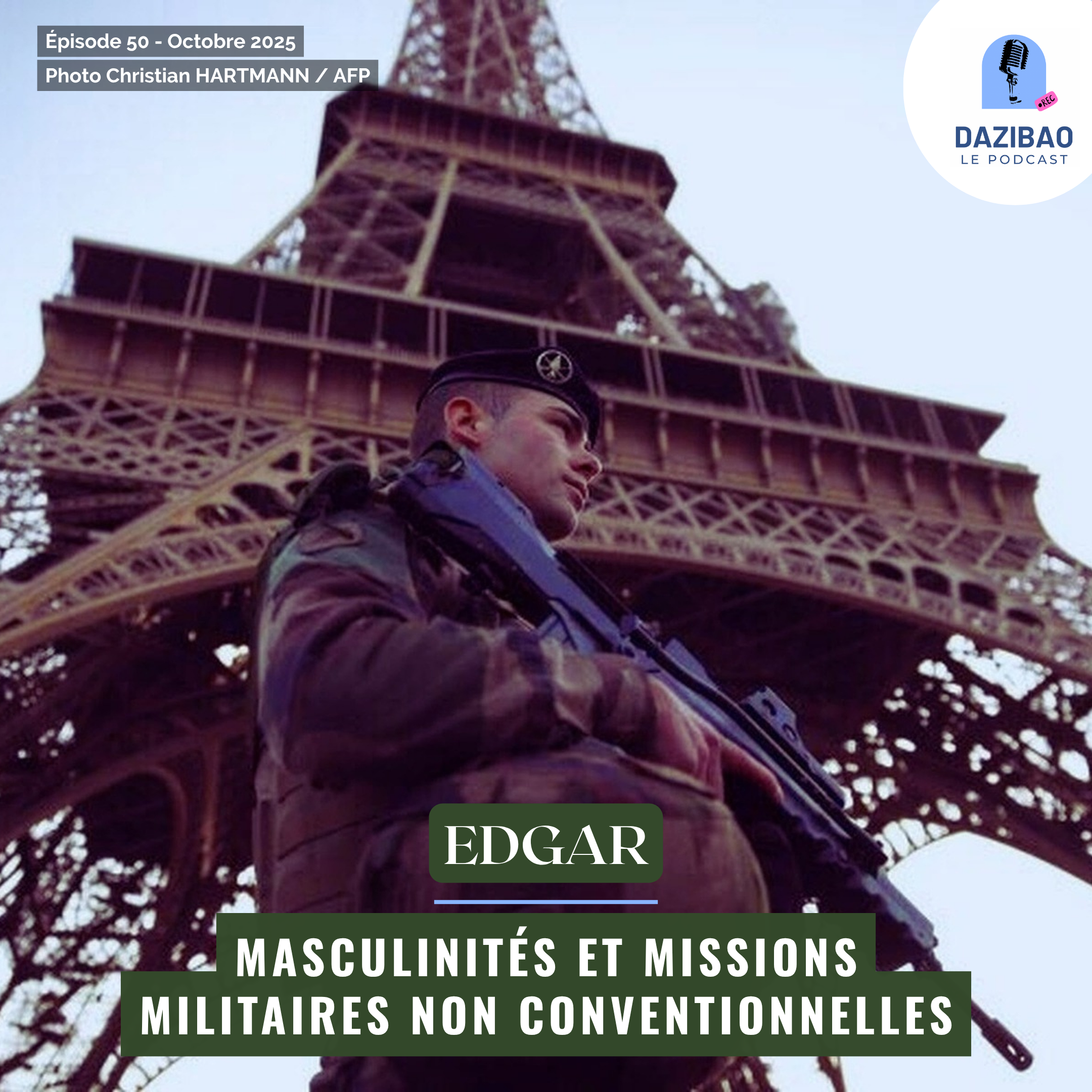

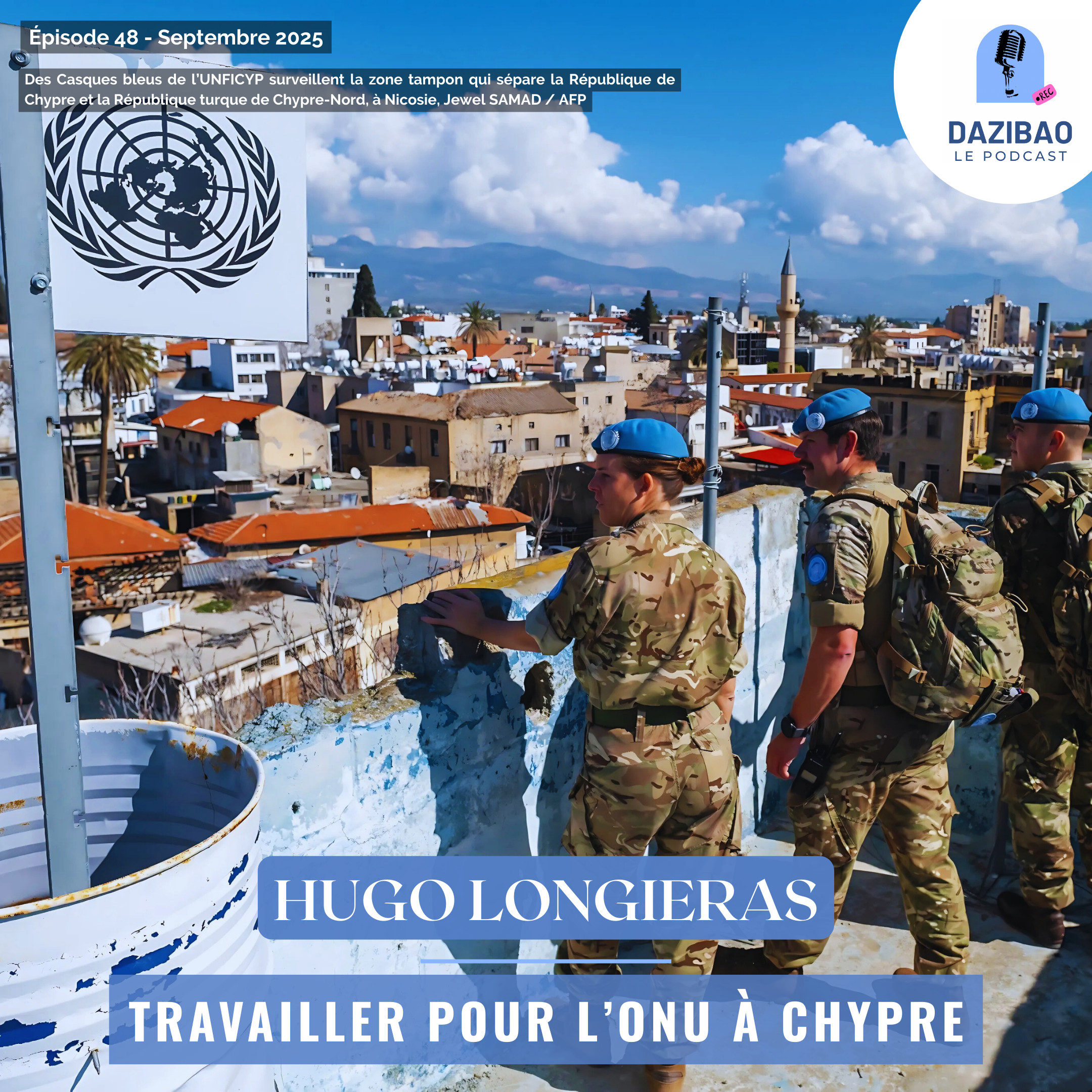
One thought on “Épisode 52 : Elias – « Guerre(s) du Futur ».”