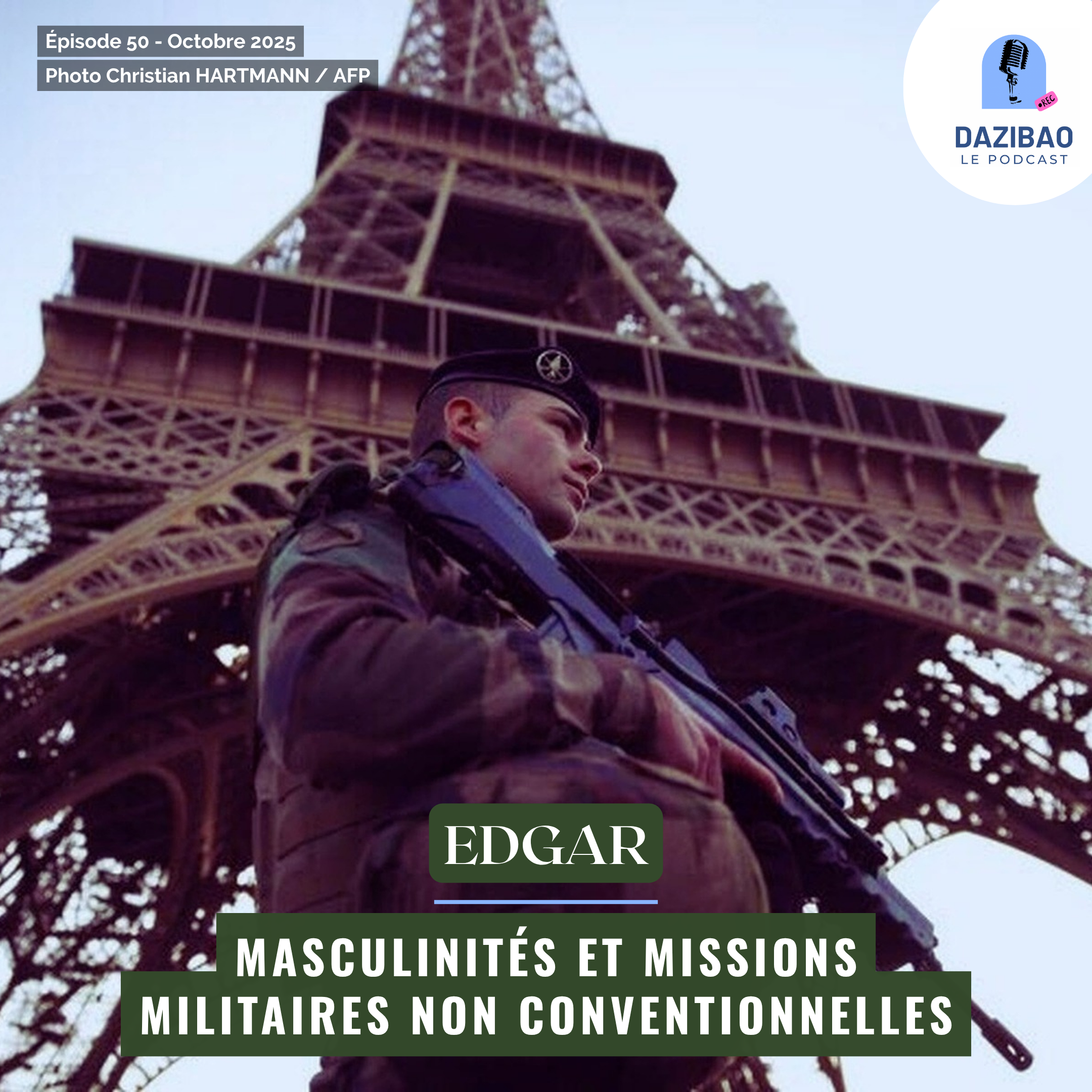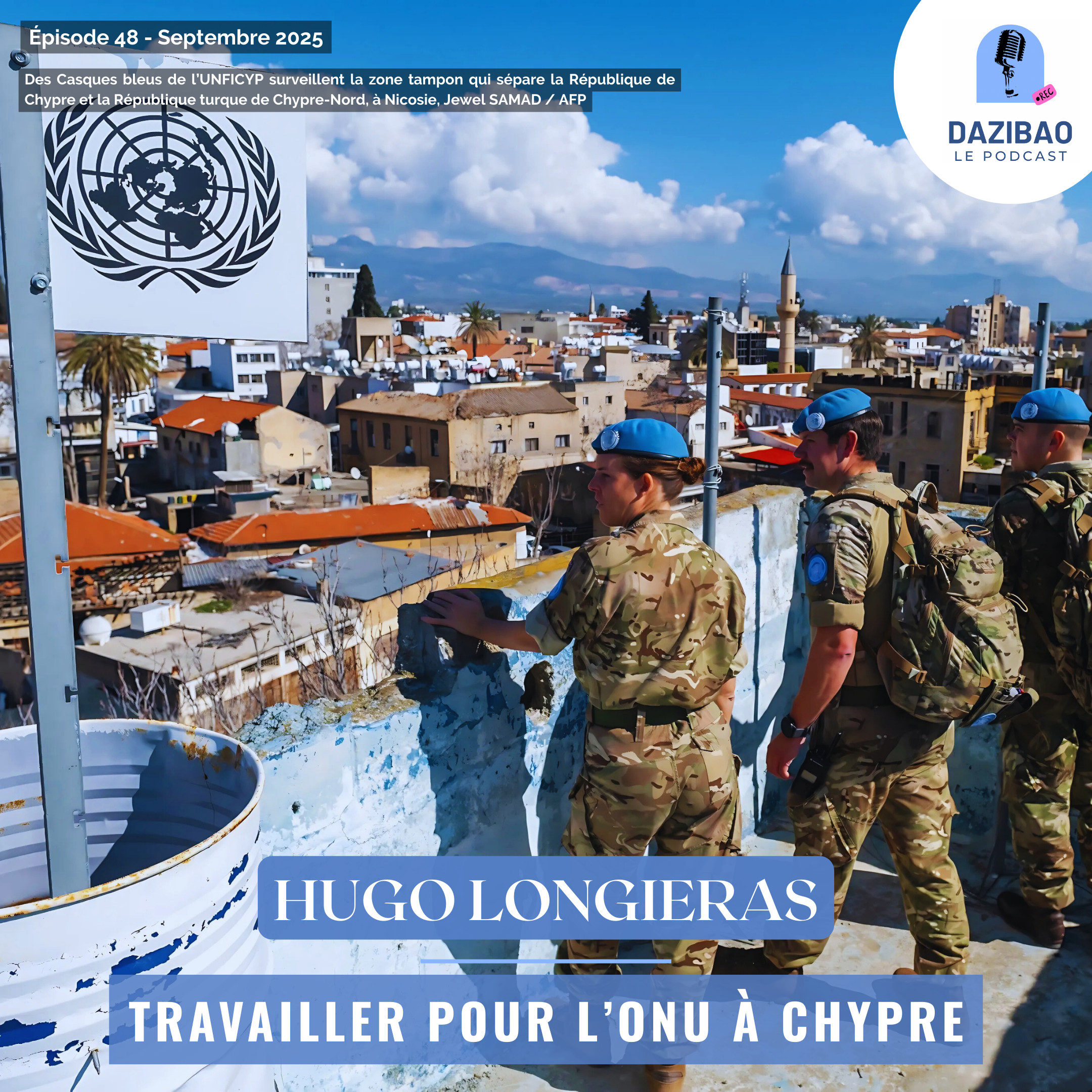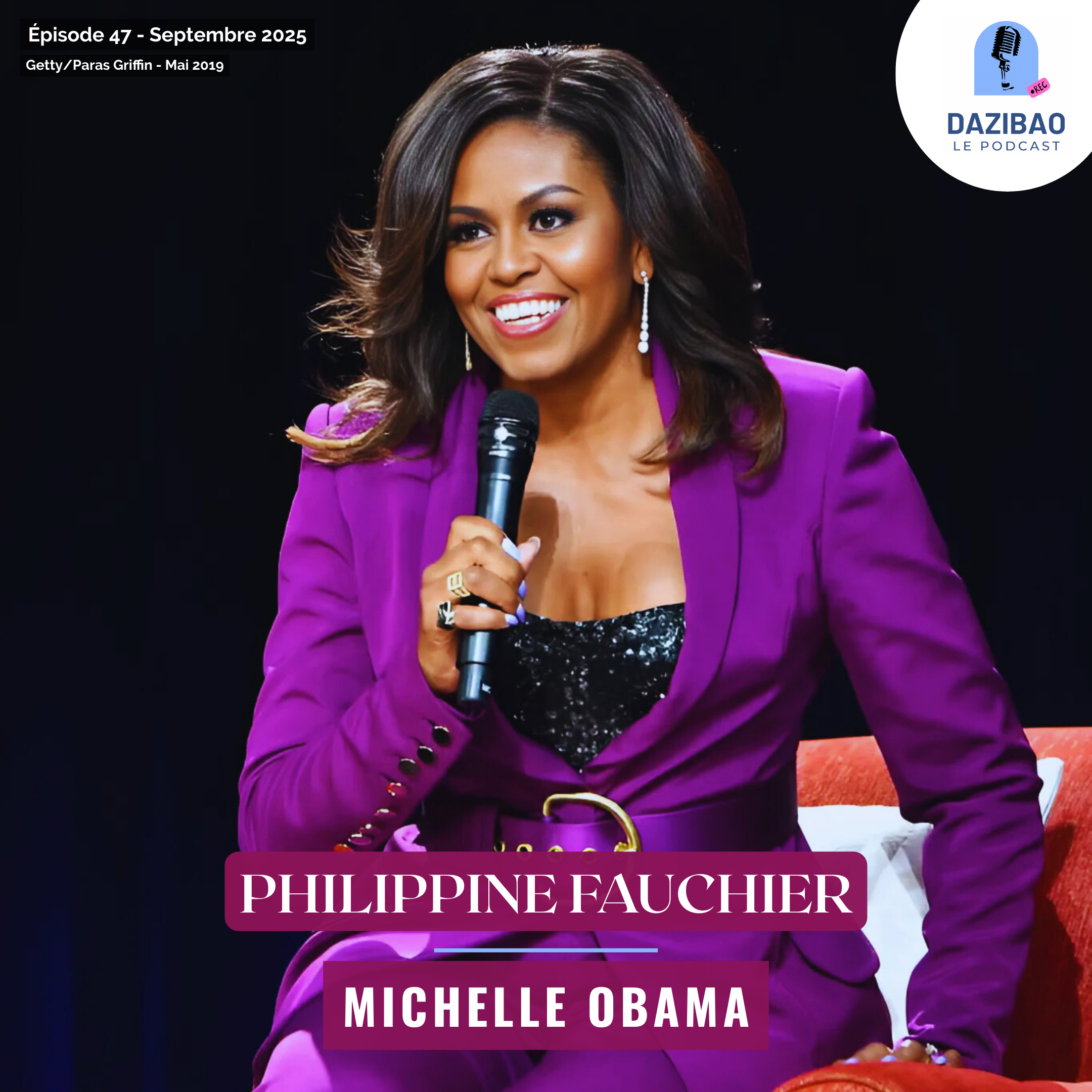Épisode 50 : Edgar – Masculinités et missions militaires non conventionnelles.
Je suis très heureuse d’accueillir Edgar pour discuter de son mémoire de M2 en science politique – relations internationales, « Masculinising security: Micro-politics of militarism in non-conventional military operations / Masculiniser la sécurité : Micro-politique du militarisme dans les opérations militaires non conventionnelles: les cas de l’opération sentinelle et de la FINUL» . Edgar a réalisé son mémoire sous la direction du professeure Chiara Ruffa à Sciences Po Paris.
Résumé
Edgar explore comment les missions « non conventionnelles » – du maintien de la paix (UNIFIL) aux déploiements intérieurs (Opération Sentinelle) – transforment à la fois le rôle des soldats et la façon dont la société conçoit la sécurité. À la croisée des études de genre et des relations internationales, son mémoire montre que ces missions, loin de « démasculiniser » l’armée, contribuent souvent à masculiniser la sécurité en recréant, à l’échelle micro-politique, des normes et des rythmes qui renforcent des formes de masculinité militaire.
Après avoir retracé son propre parcours, Edgar nous explique comment il a choisi d’étudier les « masculinités militarisées » hors du cadre des conflits ouverts : comment les soldats vivent et donnent sens à des missions de sécurité « sans guerre » (patrouilles, protection civile, coopération civilo-militaire) et pourquoi ces missions restent majoritairement masculines.
Sur le plan théorique, il mobilise la notion de micro-moves (affect — espace — temps) pour montrer que la reproduction de la domination masculine passe par des pratiques quotidiennes : l’émotion et la « professionnalisation affective » du soldat, la centralité symbolique de la caserne (qui réaménage et « re-masculinise » le sens des missions), et une temporalité militaire — rapide, orientée vers l’action — qui ne convient pas aux logiques politiques longues des missions de paix. Ces trois dimensions expliquent pourquoi l’extension des tâches militaires n’a pas produit une rupture profonde des hiérarchies de genre.
Empiriquement, le travail repose sur une vingtaine d’entretiens (officiers, sous-officiers, militaires du rang), des observations « sur base », des focus groups et des sources doctrinales, montrant à la fois des tentatives d’adaptation (comportements de protection, tâches civiles) et des mécanismes de récupération qui réaffirment la place des hommes dans la sécurité. Le mémoire souligne aussi les risques démocratiques : banalisation de la présence militaire en milieu civil, dilution de l’espace politique au profit d’un « réflexe militaire » et faible encadrement politique des objectifs de ces missions.
Enfin, Edgar n’enferme pas son diagnostic dans un pessimisme absolu : il identifie des « fissures » – pratiques locales, régiments plus inclusifs, expériences de professionnalisation émotionnelle – qui peuvent, si elles sont consolidées, ouvrir des voies de transformation. Mais ces « micro-cracks » restent précaires et souvent réabsorbées par la culture dominante du métier des armes.
Chapitrage
00h 00min 00s : Parcours
Edgar revient sur ses études en science politique, sa rencontre avec les écrits de Catherine MacKinnon et ses premières expériences de recherche à Jérusalem, autour de la mémoire palestinienne et du rôle des institutions religieuses.
00h 11min 38s : Choisir son sujet
Comment Edgar a décidé de travailler sur les « masculinités militarisées » en se détournant des conflits armés classiques pour se concentrer sur les opérations de sécurité hors guerre.
00h 17min 51s : Les opérations non conventionnelles
Pourquoi Edgar s’est intéressé à Sentinelle en France et à la FINUL au Liban, deux missions emblématiques qui questionnent l’usage de l’armée en temps de paix.
00h 20min 37s : Militarisme et société
Qu’entend-on par « militarisme » ? La demande sociale envers l’armée, la banalisation de sa présence dans l’espace public et la façon dont elle vient concurrencer d’autres priorités politiques.
00h 32min 49s : Une comparaison déviante
Choisir d’étudier ensemble deux opérations très différentes pour éclairer, par contraste, la manière dont les militaires se positionnent et dont la société perçoit leur rôle.
00h 36min 20s : Temps de paix
Comment l’un des plus gros déploiements militaires de l’histoire française peut avoir lieu sans guerre, et comment cette situation est devenue presque invisible aux yeux de l’opinion publique.
00h 39min 47s : Des armées encore masculines
Pourquoi, malgré l’ouverture, les missions restent largement dominées par les hommes, et en quoi l’armée demeure une institution peu représentative de la société.
00h 47min 00s : Masculinités alternatives
Explorer d’autres façons d’être soldat : collaboration plutôt que domination, vulnérabilité assumée, reconnaissance de la diversité des identités de genre.
00h 51min 11s : L’approche micro-politique
Une analyse à travers trois dimensions – affect, espace et temps – pour comprendre comment les pratiques quotidiennes des soldats produisent du pouvoir et façonnent leur identité.
01h 00min 00s : Les émotions du soldat
La reconnaissance reçue des civils, l’importance du soutien familial, l’impact psychologique des missions répétitives et la question de la santé mentale dans l’armée.
01h 12min 00s : La vie en caserne
Une socialisation très masculine, peu de femmes rencontrées lors de l’enquête, et une division sexuée du travail qui renforce les inégalités malgré des exceptions locales.
01h 18min 57s : « Faire peu » mais exister
Le paradoxe de missions jugées peu « utiles » par certains militaires, mais valorisées par d’autres, notamment les officiers qui y voient un enjeu de commandement et de gestion d’équipe.
01h 26min 02s : Le rapport au temps
La temporalité militaire (efficacité, urgence, objectif clair) face à la temporalité politique (longue, négociée, incertaine), et la difficulté d’adapter l’institution à des missions sans ennemi.
01h 35min 38s : Qui doit assurer ces missions ?
Débat sur la pertinence d’engager des militaires pour des tâches qui pourraient relever de civils (policiers, enseignants, travailleurs sociaux), et réflexion sur ce que nous acceptons du « fait militaire ».
01h 42min 15s : Genre et institution militaire
Les missions non conventionnelles n’ont pas dégenré l’armée comme on aurait pu l’imaginer ; au contraire, elles ont souvent renforcé l’image du soldat protecteur et les normes masculines.
01h 45min 30s : Faire sa recherche dans l’armée
Comment Edgar a pu accéder au terrain, construire sa méthodologie et composer avec une institution fermée et méfiante envers les chercheurs.
Ressources complémentaires
Livres
- Eichler, Maya. 2012. Militarizing Men: Gender, Conscription, and War in Post-Soviet Russia. Stanford University Press.
- Dorlin, Elsa. 2019. Se Défendre : Une Philosophie de La Violence. La Découverte.
- Boutron, Camille. 2024. Combattantes : Quand Les Femmes Font La Guerre. Les Pérégrines.
- Debos, Marielle. 2013. Le Métier Des Armes Au Tchad : Le Gouvernement de l’entre-Guerres. Éditions Karthala.
- Enloe, Cynthia. 2000. “How Do They Militarize a Can Of Soup?” In Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives. University of California Press.
Articles cités dans le mémoire
- Basham, Victoria M., Aaron Belkin, and Jess Gifkins. 2015. “What Is Critical Military Studies?” Critical Military Studies 1 (1): 1–2.
- Basham, Victoria M. 2016. “Raising an Army: The Geopolitics of Militarizing the Lives of Working-Class Boys in an Age of Austerity.” International Political Sociology 10 (3): 258–74.
- Wibben, Annick T. R. 2018. “Why We Need to Study (US) Militarism: A Critical Feminist Lens.” Security Dialogue 49 (1–2): 136–48.
- Solomon, Ty, and Brent J. Steele. 2017. “Micro-Moves in International Relations Theory.” European Journal of International Relations 23 (2): 267–91.
- Debos, Marielle. 2023. “Genre, sécurité et éthique. Vade-mecum pour l’enquête de terrain.” Critique internationale (Paris) 100 (3): 59–73.
- Debos, Marielle. 2019. “Regard sur… le genre de la guerre de Marielle Debos, à partir des travaux de Cynthia Cockburn, Jules Falquet et Andrée Michel.” Travail, genre et sociétés (Paris) n° 41 (1): 199–203.
Extraits
Newsletter
Pour ne rien rater et en apprendre plus sur les coulisses du podcast 🎭 :
Merci pour votre soutien 🔥 !
Marjolaine