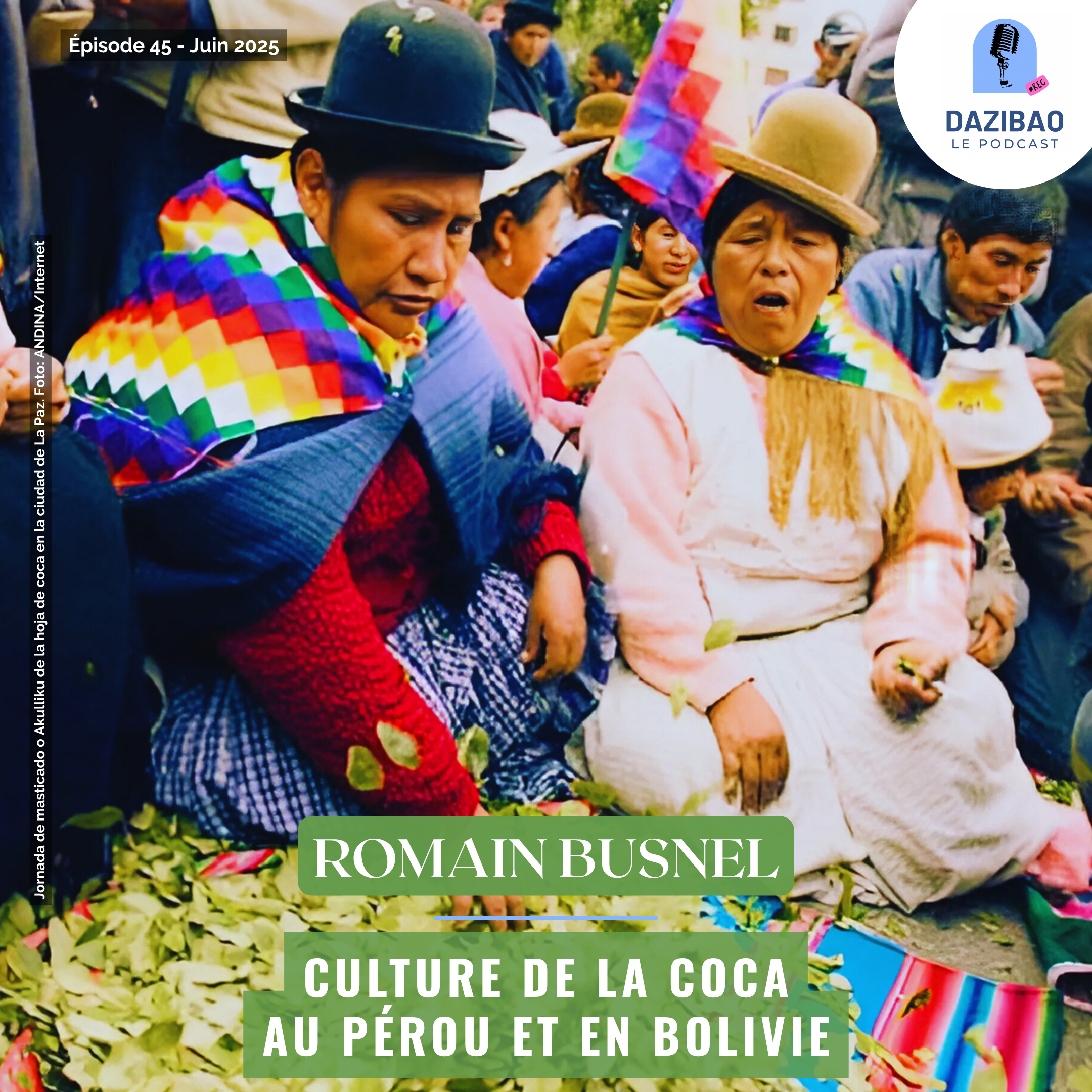Épisode 46 : Benjamin – Israël, le Sinaï et Gaza.
Résumé
« La terre contre la paix ? » – Le désengagement israélien vu du Sinaï et de Gaza
Pourquoi le Likoud, parti historiquement favorable à la colonisation, a-t-il mené les deux principaux désengagements territoriaux israéliens de son histoire ?
En 1979, Menahem Begin restitue la péninsule du Sinaï à l’Égypte. En 2005, Ariel Sharon retire les colons de la bande de Gaza et de quatre petites colonies en Cisjordanie. Deux gestes spectaculaires, à contre-courant de la ligne dure défendue par leurs auteurs. Deux énigmes politiques, qu’il faut comprendre à l’aune des priorités géostratégiques, militaires, idéologiques et diplomatiques de l’État israélien.
Dans cet épisode, on revient sur les ressorts profonds de ces décisions a commencé par la hiérarchisation des territoires occupés. La Cisjordanie, Jérusalem et Hébron – au cœur du mythe du « Grand Israël » – possèdent une valeur religieuse, stratégique et symbolique sans commune mesure avec celle de Gaza ou du Sinaï. Dans l’imaginaire nationaliste sioniste, cette hierarchie rend possibles certains renoncements, tant qu’ils renforcent ailleurs la mainmise israélienne.
Il faut aussi lire ces désengagements dans le contexte international. La restitution du Sinaï se produit sous la pression de l’administration Carter, dans une conjoncture où Israël ne peut se permettre de perdre l’appui stratégique de Washington. La guerre du Kippour, en 1973, a ébranlé la confiance des Israéliens dans l’invincibilité de leur armée : rendre le Sinaï, c’est neutraliser un front et sécuriser ses arrières.
Le retrait de Gaza, quant à lui, est lié à des motivations tout aussi pragmatiques. Occupée par 8 000 colons protégés par trois fois plus de soldats, au cœur d’une population palestinienne d’un million d’habitants, la bande de Gaza devient une charge militaire et économique difficilement tenable. L’administration Bush, dans l’après-11 septembre, souhaite calmer les tensions au Proche-Orient et soutient officiellement pour la première fois l’idée d’un futur État palestinien. Dans ce contexte, Sharon opère un « bold move » pour montrer sa bonne volonté — mais aussi, comme l’indique une lettre clé de George W. Bush, pour mieux sécuriser le droit d’Israël à maintenir ses colonies en Cisjordanie.
Ces gestes ne sont donc pas des concessions altruistes, mais des transferts calculés, où le retrait est le prix à payer pour renforcer sa main ailleurs. En rendant un territoire, on s’assure le soutien des alliés, on soulage son armée, on rassure l’opinion publique – et on verrouille les positions considérées comme vitales.
L’épisode aborde aussi la manière dont ces décisions ont été prises — dans un entre-soi politique restreint, sans concertation élargie —, leur réception par la société israélienne, les réactions internes au Likoud, ainsi que le rôle de l’armée dans leur mise en œuvre. On y explore enfin ce paradoxe : pourquoi la droite israélienne, et non la gauche travailliste, a-t-elle été capable de mener à bien ces retraits ? Et ce que cela dit, plus largement, de la structure du pouvoir en Israël, de la place des colons dans la vie politique, et de la manière dont les gestes de paix peuvent aussi servir des logiques de domination.
Une plongée dans les contradictions apparentes — mais parfois très cohérentes — de la politique territoriale israélienne.
Mon invité a réalisé son mémoire de Master 2 en sciences politiques – relations internationales sous la direction du Professeur Frédéric Ramel à Sciences Po Paris.
Chapitrage
00:00 – Parcours de recherche : un échange universitaire à Jérusalem, une prise de conscience politique, et le déclic de travailler sur la droite israélienne à travers le prisme du Likoud.
05:00 – Lecture du livre Israël, une démocratie fragile de Samy Cohen : les paradoxes des désengagements territoriaux initiés par des dirigeants de droite.
08:10 – Panorama du système politique israélien : fonctionnement de la Knesset, multipartisme, poids des coalitions, et positionnement du Likoud dans l’échiquier politique.
11:28 – Les fondements idéologiques du Likoud : le « Grand Israël » et la théorie du « Mur de fer » de Jabotinsky. Une vision politique fondée sur la puissance militaire, le refus du compromis et l’exclusion des Palestiniens.
14:54 – Contexte historique : comment Gaza et le Sinaï passent sous contrôle israélien après la guerre des Six Jours.
17:50 – Hiérarchisation stratégique et symbolique des territoires occupés : Gaza et le Sinaï face à la Cisjordanie, Jérusalem et Hébron.
23:07 – Ce qui pousse Begin et Sharon à la rétrocession : pressions diplomatiques, nécessité sécuritaire, et priorisation de la Cisjordanie.
27:40 – Le rôle déterminant des États-Unis dans les processus de désengagement israéliens : Carter, Bush, la « feuille de route », et la diplomatie post-11 septembre.
33:00 – Les logiques derrière le désengagement de Gaza en 2005 : perception israélienne de Gaza comme territoire secondaire, et stratégie de « bonne volonté » envers les alliés.
38:35 – Gaza comme « test » : transfert de la charge de la preuve aux Palestiniens, selon la rhétorique israélienne.
39:52 – Le traumatisme de la guerre du Kippour et la vulnérabilité stratégique : pourquoi Israël renonce au Sinaï.
45:03 – Coût humain, logistique et politique du maintien à Gaza : 8000 colons protégés par trois fois plus de soldats au milieu d’un million de Palestiniens.
51:00 – L’angle mort de la question palestinienne dans les négociations israélo-égyptiennes : autonomie des personnes mais pas des territoires.
55:37 – La fameuse « lettre Bush » et la consolidation du contrôle israélien sur la Cisjordanie, en parallèle du désengagement de Gaza.
1:02:00 – Prise de décision sur Gaza : processus très centralisé, opposition au sein du Likoud, et création du parti Kadima par Sharon.
1:07:00 – Pourquoi ces désengagements viennent de la droite : une gauche affaiblie, et une droite perçue comme plus légitime pour imposer des décisions unilatérales.
1:09:50 – Juin 2025 : vers une possible réinstallation de colons dans la bande de Gaza ?
1:14:00 – Retour sur l’enquête : accès à des témoins-clés, anciens collaborateurs de Sharon et diplomates américains.
1:16:57 – Pourquoi les pressions internationales ne fonctionnent plus : soutien de Trump à Netanyahou, coalition avec l’extrême droite, et conséquences du 7 octobre.
1:20:15 – Perspectives ouvertes : le positionnement du Parti travailliste après l’attentat d’Hébron en 1994, et les stratégies du Likoud vis-à-vis des minorités palestiniennes en Israël.
1:22:00 – Après le M2 : ce que la recherche a changé, et conseils de Benjamin pour les futurs étudiants.
Ressources complémentaires
Cité dans le podcast
- Allison, Graham T et Philip D Zelikow. “L’essence de la décision. Le modèle de l’acteur rationnel”, Cultures & conflits. 2000 no 36
- Cohen, Samy. Israël : une démocratie fragile. Paris : Fayard CERI. 2021.
Bibliographie
- Cornut, Jérémie et Dario Battistella. Les excuses dans la diplomatie américaine : pour une approche pluraliste des relations internationales. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 2018.
- Cowen, Tyler et Daniel Sutter. “Why Only Nixon Could Go to China”, Public choice. 1998, vol.97 no 4.
- Dieckhoff, Alain. Les espaces d’Israël : essai sur la stratégie territoriale israélienne. Paris : Fondation pour les études de défense nationale. 1987.
- Enderlin, Charles. Paix ou guerres : les secrets des négociations israélo-arabes, 1917-1997. Paris : Stock. 1997.
- Filiu, Jean-Pierre. Main basse sur Israël : Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Paris : la Découverte. 2019.
- Fuentes-Carrera, Julieta et Subra, Philippe. Israël, l’obsession du territoire. [s.l.] Armand Colin. 2018.
- Kaspi, André. “Les États-Unis et Israël sous la présidence de George W. Bush: L’Amérique de George W. Bush”, Vingtième siècle (Paris. 1984). 2008 no 97.
- La Balme, Natalie et Dieck, Hélène. “Partir en guerre ou s’abstenir : l’influence de l’opinion publique”, Inflections : civilians and military : being able to say. 2010, vol.14 no 2.
- Mansour, Maha Samman. “Israeli Colonial Contraction : The Cases of the Sinai Peninsula and the Gaza Strip”, Birzeit University. 2011.
- Shindler, Colin. The rise of the Israeli right : from Odessa to Hebron. New Y ork : Cambridge University Press. 2015.
- Roy, Sara. “Praying with Their Eyes Closed: Reflections on the Disengagement from Gaza,” Journal of Palestine studies. 2005, vol.34 no. 4.
Presse
- Shavit, Ari. “The big freeze”, Haaretz. 6 octobre 2004.
Films documentaires
- Moreh, Dror. « Sharon » [DVD]. Zero One Film GmbH. 2007. 90 minutes.
- Damoisel, Mathilde. “Sadate-Begin, le chemin de la paix” [DVD], 13 Productions. 2011. 52 minutes.
Extraits
Newsletter